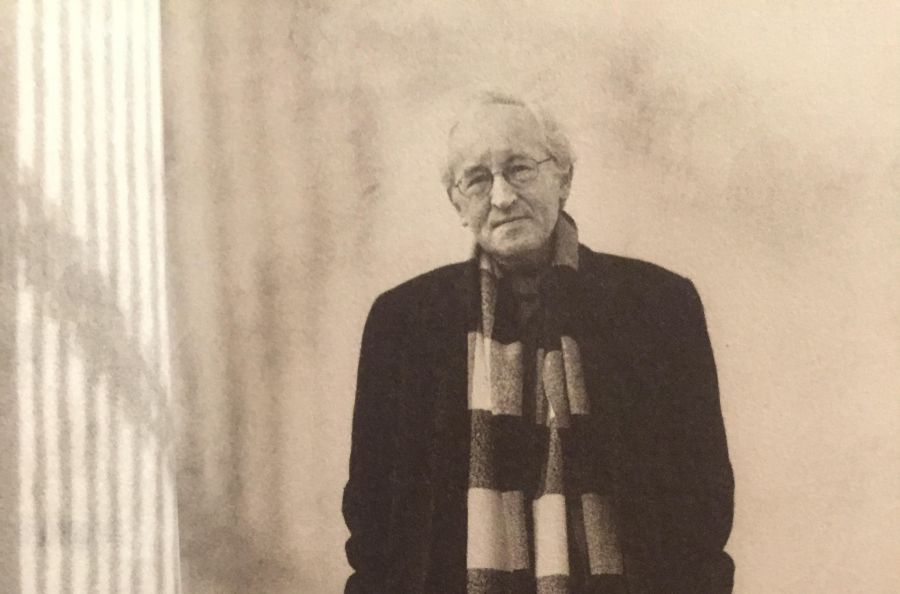Jacques Bouveresse, le combat pour la raison et pour la vérité
« La bonne démarche consiste à associer les pensées mortes aux vivantes et à reconnaître l’importance des deux. Très tôt, je me suis senti appelé à servir les pensées vivantes, et de toute ma vie, je n’ai pu faire autre chose que défendre les mortes contre les malentendus des vivantes. » Robert Musil, L’homme sans qualités.
Cette seule citation de L’homme sans qualités donne un aperçu du travail philosophique et des combats qui ont nourri l’oeuvre de Jacques Bouveresse, qui vient de nous quitter. Face au succès de l’antirationalisme, du relativisme et d’une métaphysique réactionnaire, Bouveresse n’a cessé de défendre la raison, les Lumières et le réalisme. Dans ces choix et ces positionnements, l’enjeu fut toujours de défendre ce qui lui semblait injustement attaqué. Il s’identifiait d’ailleurs assez fréquemment à des figures comme celle de Karl Kraus, qui représentait pour lui « l’homme de la juste colère ». C’est ce sentiment d’injustice et de malhonnêteté qui lui a dicté nombre de ses ouvrages, motivés par ce qu’il appelait des « émotions rationnelles ».
Passionné de musique et de littérature, mais aussi de sciences, au sujet desquelles il éprouvait le regret de ne pas avoir suffisamment de connaissances, il héritait d’une culture encyclopédique et de l’universalisme des philosophes des Lumières. C’est pourquoi il refusait, non sans malice, les impératifs académiques de la spécialisation et l’organisation institutionnalisée des champs disciplinaires. Ses nombreux travaux sur Musil témoignent de ce souci de questionner les frontières, en l’occurrence, entre philosophie et littérature, ne sacrifiant toutefois jamais l’exactitude à la profondeur, se gardant de succomber au vertige de l’analogie.
Jacques Bouveresse vient de s’éteindre et il laisse orphelin toute une génération de chercheurs marquée par son œuvre et sa conception de la philosophie. Je n’appartiens pas à la génération des « élèves » de Bouveresse, qui ont prolongé pour les uns, les études wittgensteiniennes qu’il a introduites en France, pour les autres, ses travaux sur le rationalisme et la connaissance. Je fais partie de la « seconde génération », celle des élèves de ses élèves qui n’en finissent pas d’hériter de sa pensée.
Bouveresse, c’est d’abord un style d’écriture philosophique, habité par l’exigence de clarté conceptuelle, de rigueur et de précision. Une écriture modeste, adoptant le principe de la citation, pour énoncer avec pudeur ses propres thèses et arguments. Bouveresse, c’est aussi une éthique de la philosophie, soulignée par son refus de s’ériger en « maître » de qui que ce soit. A rebours des postures de séduction, il s’est donné pour tâche de définir une philosophie décente, contre les illusions et les formes de domination produites par les philosophes eux-mêmes. Ce qui me vient à l’esprit lorsque je repense à ses exigences, c’est la probité, vertu intellectuelle aussi bien que morale. Même sa défense du réalisme s’ancrait dans des motifs éthiques, ceux de faire droit à la réalité des expériences vécues, notamment celles de la souffrance.
Comme les positivistes du Cercle de Vienne, qu’il appréciait malgré ses désaccords, il était soucieux de ne pas s’en laisser conter, d’opérer une déflation permanente des discours un peu trop gonflés. C’était aussi pour lui un héritage familial, celui du « bon sens paysan », de ce sens commun dont il ne s’est jamais départi, le tenant en bien plus haute estime que bien des discours philosophants. Imprégné par l’oeuvre de Musil, il aimait convoquer l’image des « baudruches métaphysiques », pourfendant avec ironie les enthousiasmes démesurés. Il martelait l’idée, sonnant comme un mantra à mes oreilles, que « le pied le plus bas est aussi le plus sûr ». Il veillait à ne pas pratiquer une philosophie hors-sol et à revenir sans cesse, presque laborieusement, au concret et à la réalité ordinaire.
Le Bouveresse que j’ai connu était plutôt musilien que wittgensteinien, prenant au sérieux la littérature, le romanesque, convaincu que les œuvres de Musil représentaient une contribution philosophique plus précieuse que celles de nombreux philosophes de la tradition usuelle. Il aimait le léger décalage ou décentrement de la culture autrichienne, sa tonalité ironique, qu’il a largement insufflé à son oeuvre. Le Witz de Bouveresse, entre critique rationaliste et quête de sens.
Dans ces années-là, je me souviens d’un Bouveresse partagé entre les pensées vivantes et les pensées mortes, écrivant avec minutie, malgré tout dans une certaine urgence, des livres sur la connaissance en littérature, sur la religion et la foi. Et sur le face à face de l’athée avec la mort. De l’homme, je ne partagerai que la grande bienveillance, les encouragements à l’adresse des jeunes chercheurs et la simplicité.
Aujourd’hui se pose à nous la question de savoir comment nous héritons de cet immense philosophe que fut Bouveresse. Il suivait avec une curiosité réjouie les chemins buissonniers que prenait ma façon de m’approprier son souci de la précision et du réalisme, et bien d’autres choses encore. J’ai choisi, son sous regard bienveillant, le pied le plus bas, en développant ce que j’aime appeler une philosophie de terrain, analysant les usages du langage dans les campements de migrants et autres jungles. Je crois que cela l’amusait beaucoup de voir comment se déployait sa postérité légitime et illégitime. Nous n’avons pas encore pris la mesure de notre dette à l’égard de Bouveresse, des traditions hétérodoxes qu’il nous a fait découvrir, du type de réalisme qu’il a façonné, de la manière dont il nous a, pour beaucoup, libéré d’un certain antirationalisme qui s’imposait comme une mode philosophique postmoderne et réconcilié avec la raison. Il nous incombe de faire ce travail et de poursuivre son combat pour la vérité.