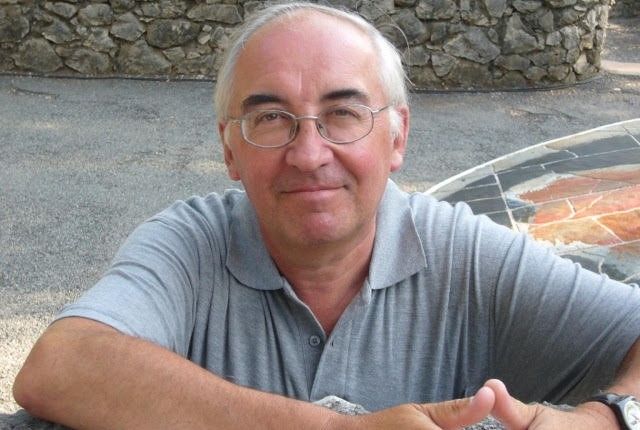Le choix de la guerre civile : Une autre histoire du néolibéralisme, Pierre Dardot, Haud Guéguen, Christian Laval, Pierre Sauvêtre
Le néolibéralisme ferment de guerre civile, par Pierre
Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvêtre sous le regard aiguisé d’Alain
Lhomme
Un renouveau de la
critique du néolibéralisme : la centralité de la stratégie de guerre
civile
Après
une brève présentation des auteurs, sociologues et philosophes, dont Haud
Guéguen, malheureusement absente, la conférence est présentée par Alain Lhomme,
philosophe également. Le livre s’articule pour Pierre Dardot et Christian Laval
autour d’un réexamen des critiques déjà édictées contre le néolibéralisme dans
leur ouvrage de 2009, La nouvelle raison du monde, Essai sur la société
néolibérale. Les coauteurs y reconnaissent une vision trop bourdieusienne
se focalisant trop sur la violence symbolique centrée sur l’Occident. Ainsi,
leur nouveau livre prend comme point de départ le Chili de Pinochet, première
expérience de politique néolibérale à partir de 1975, et part de l’exemple de
l’extrême violence de ce régime illégitime afin de démontrer qu’il ne s’agit en
rien d’une erreur de parcours d’un néolibéralisme qui serait globalement
démocratique et pacifiste. Les auteurs se concentrent alors sur le contexte de
création du néolibéralisme autour de Friedrich Hayek et de l’école autrichienne
dès les années 1930. Suite à l’échec politique du libéralisme néoclassique face
aux mouvances keynésiennes d’une part et au socialisme d’autre part, ces
intellectuels ont tenté de fonder une nouvelle organisation politique plus
solide. Suivant les auteurs, celle-ci s’organise autour de deux axes. D’une
part, de manière contre-intuitive, autour de la centralité de l’État :
Dardot rappelle ainsi l’admiration du néolibéral Ludwig von Mises pour ce qu’il
considère comme « l’œuvre civilisatrice du fascisme ». En effet,
l’État reste la pièce maîtresse du développement du néolibéralisme, en
particulier dans un contexte de mondialisation comme aujourd’hui, où les États
sont en concurrence entre eux pour la place de meilleur promoteur des intérêts
du marché libre. D’autre part, second axe politique des néolibéraux fondateurs,
la désignation par l’État d’ennemis à combattre et de groupes sociaux à mettre
en lutte les uns contre les autres : le principe de guerre civile. Pierre
Sauvêtre rappelle que pour l’école autrichienne, les ennemis sont les
socialistes, mais aussi les syndicalistes, les militants de la contre-culture,
les militants de la démocratie réelle, tous ceux qui pourraient mettre en
danger le marché et contre lesquels l’État doit intervenir autant que
nécessaire, notamment en créant des divisions au sein de la population.
Christian Laval explique que cette logique de guerre civile va dans le sens
d’une « mise en marché de toutes les institutions et acteurs de la
société », et d’une logique de concurrence permanente entre eux.
Une conférence
intellectuellement brillante mais peut-être trop théorique.
Les
conférenciers épatent d’abord par leur éloquence et leur explication limpide et
éclairante de cet enjeu central. Toutefois, le livre n’échappe pas à certaines
critiques relevées par Alain Lhomme telles que l’insuffisante clarté
définitionnelle des termes utilisés, notamment celui de néolibéralisme, parfois
perçu comme un ordre omniscient, ou le manque de référence à la lutte des
classes, malheureusement balayé d’un revers de la main par Pierre Dardot dans
son rejet personnel d’un marxisme auquel il adhéra auparavant. On pourrait reprocher
au trio de chercheurs leur excessive focalisation sémantique et leur
comparaison avec une situation réelle de guerre civile. On peut, finalement,
regretter l’absence de solutions et de réponses politiques que les chercheurs
apportent au développement d’un néolibéralisme toujours plus hégémonique,
laissant un goût amer de fatalisme. La conférence reste néanmoins très
enrichissante et présente une critique acerbe et douloureuse, mais réaliste, du
néolibéralisme.