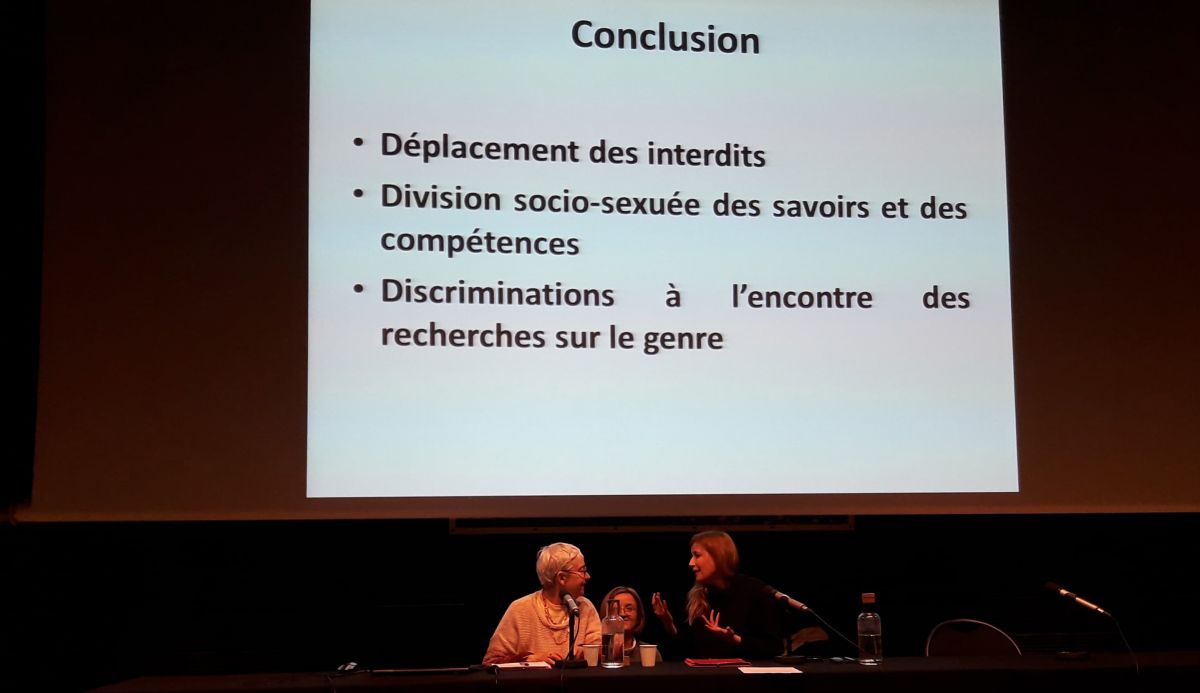L’accès des femmes au savoir : progrès ou reconfiguration de la société ? par Nicole Mosconi et Caroline Fayolle
Longtemps maintenues dans
l’ignorance, les femmes ont aujourd’hui librement accès au savoir. Ou
presque. Caroline Fayolle, maîtresse de
conférence en histoire à l’Université de Montpellier, et Nicole Mosconi,
professeure émérite en sciences de l’éducation, reviennent sur ces dynamiques
mal connues, de la Révolution française à aujourd’hui.
Les femmes, un maillon de la
République
Éduquer les femmes à
émanciper les hommes. Les premières écoles publiques pour filles naissent sous
la Révolution française avec cet objectif. Pour les révolutionnaires,
l’éducation est toute puissante : elle efface les disparités artificielles
entre les hommes. Un obstacle subsiste, les différences sexuelles,
insurmontables car ancrées dans la nature. L’argumentaire biologique,
incontestable, est convoqué. « Le cerveau des femmes est beaucoup plus
petit (…), elles sont donc moins intelligentes », explique Emile
Durkheim, sociologue, en 1894. Les
universités sont interdites aux filles depuis le Moyen-Âge. Pourquoi alors
choisir de les éduquer ? Pour former des mères républicaines qui sauront
élever des citoyens libres. Ces écoles seront supprimées sous l’Empire. Mais
l’idéologie républicaine s’est enracinée dans les esprits. Certaines femmes
l’assument jusqu’au bout : si l’éducation est réellement toute puissante,
ne peut-elle pas également permettre l’égalité des sexes ?
En 1880, la Troisième
République offre aux femmes l’accès au petit savoir. L’école primaire laïque
est rendue obligatoire pour tous les enfants et l’enseignement secondaire
s’ouvre aux filles de la bourgeoisie. Cependant, cette formation ne permet pas
l’accès à l’université, ni même au baccalauréat. L’objectif n’est pas de faire
des savantes mais de bonnes épouses et de bonnes mères. Ces petits pas
mènent néanmoins à une forte progression des filles dans l’enseignement
secondaire et supérieur après la Seconde Guerre mondiale. En 1861, Julie-Victoire Daubié est la
première femme à obtenir le baccalauréat. L’accès au savoir se généralise.
Un progrès ?
Pour Caroline Fayolle,
l’histoire ne doit pas s’envisager comme une marche inéluctable vers le
progrès. La domination masculine est polymorphe et s’est transformée au cours
du temps. Si le combat féministe a permis des avancées, l’accès des femmes au
savoir doit également se lire à l’aune d’une perpétuelle reconfiguration de la
société : la création de l’école des filles en 1793 sous-tend avant tout
un objectif politique républicain. Sous la Troisième République, il s’agit
d’arracher au plus vite les femmes des mains de l’Église. A partir de la
deuxième moitié du XXème siècle, l’accès des femmes au marché du travail répond
principalement à de nouvelles exigences économiques, et à un besoin spécifique
de main d’œuvre. Aujourd’hui, elles accèdent au savoir mais sont moins
reconnues que les hommes. Elles sont moins nombreuses à occuper des postes à
responsabilité. Dans le milieu universitaire, le savoir est genré et discriminé.
La domination se cache aussi dans les inégalités économiques, avec une
surreprésentation des femmes dans les emplois précaires.